C’est une bonne nouvelle pour le monde de la formation professionnelle. Près de 45 000 jeunes ont répondu à une vaste enquête nationale menée fin 2024 par WorkMed, le centre de compétence en psychiatrie du travail, en collaboration avec la HES‑SO du Nord-Ouest de la Suisse, et l’institut de sondage ValueQuest. Leur message est clair : la très grande majorité des apprenti‑e‑s va bien. Plus de 80 % déclarent se sentir « plutôt bien, voire très bien » dans leur quotidien d’apprentissage.
Ces jeunes ne se contentent pas de « tenir bon ». Ils et elles se disent motivé‑e‑s, fier‑e‑s de leur métier et valorisé‑e‑s dans leur environnement professionnel. Le climat de travail est décrit comme bienveillant, respectueux et encourageant. Beaucoup mentionnent une relation de confiance avec leurs formateur‑rice‑s et un cadre qui leur permet d’apprendre de leurs erreurs sans crainte.
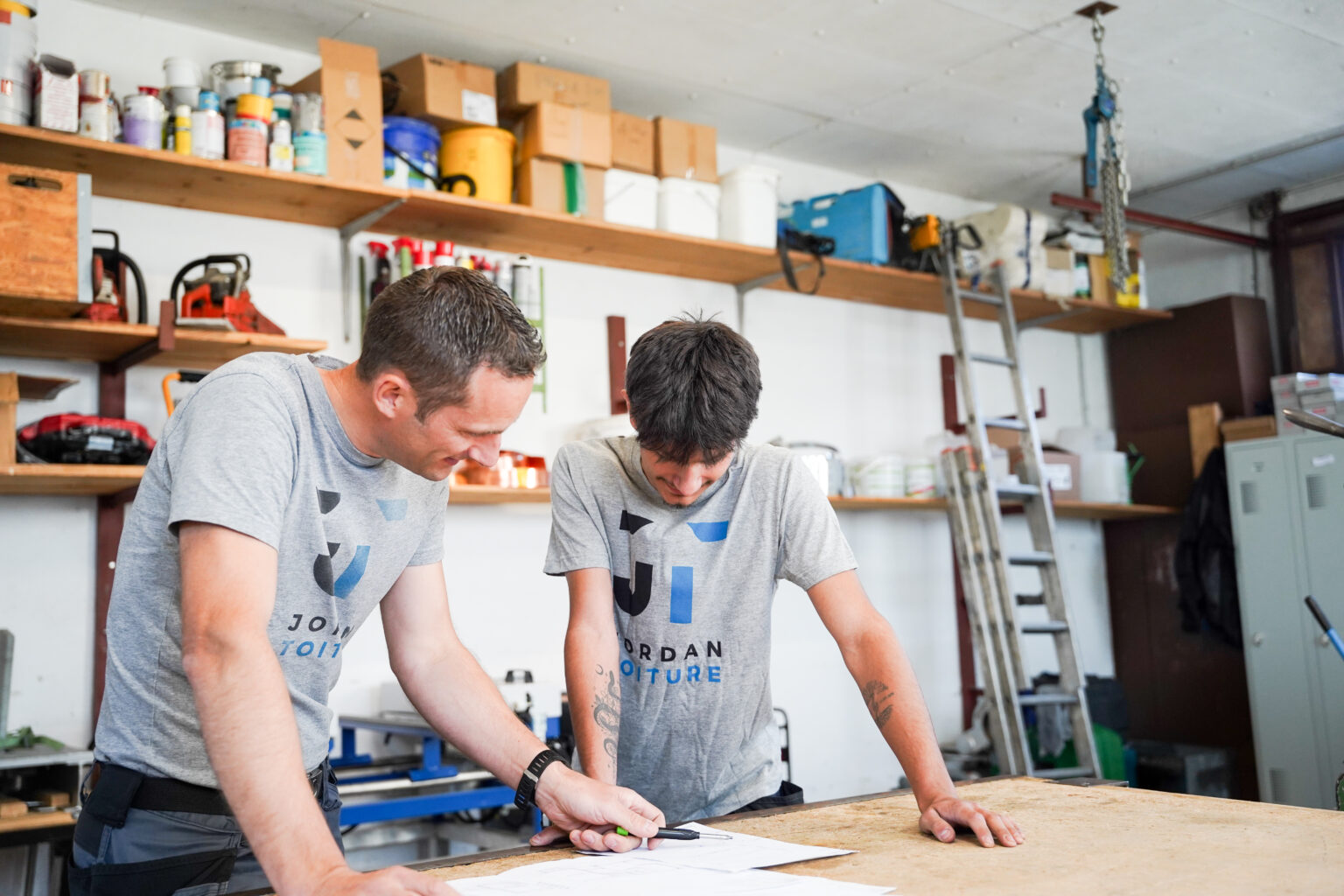
Plus qu’un apprentissage
L’étude révèle aussi la transformation intérieure que permet la formation professionnelle. Les apprenti‑e‑s déclarent avoir gagné en assurance, en autonomie, en rigueur. Près de 90 % se disent plus responsables, plus curieux-ses et plus assidu‑e‑s qu’avant leur entrée en apprentissage. « Depuis que j’ai commencé, je me sens utile. Je sais pourquoi je me lève le matin », confie par exemple un répondant‑e.
Pour Barbara Schmocker, psychologue et principale autrice du rapport, ces résultats parlent d’eux-mêmes : « La santé mentale ne se limite pas à l’absence de symptômes. Elle inclut aussi la fierté, la motivation et le sentiment d’être à sa place. »
L’enquête ne gomme pas pour autant certaines réalités plus nuancées. Environ six apprenti‑e‑s sur dix disent avoir déjà rencontré des problèmes psychiques, à différents niveaux d’intensité.
Cela peut être du stress, de la fatigue, des tensions, voire dans certains cas des troubles plus marqués. Mais ces chiffres doivent être lus avec mesure: la question posée était très large et englobe autant des épisodes passagers que des situations plus durables. Dans les faits, seul un tiers des apprenti-e-s concernés indiquent que ces difficultés ont réellement entravé leur formation.
Ce qui ressort aussi très fortement de l’étude, c’est la résilience dont font preuve les jeunes : 90 % d’entre eux disent parvenir à bien gérer les obstacles rencontrés, et trois quarts se sentent capables de faire face aux défis du quotidien. Parmi celles et ceux qui ont envisagé d’arrêter leur apprentissage, la majorité évoque leur volonté personnelle, la confiance de leur entourage ou le soutien de leurs parents comme moteurs pour continuer.


Débat sur les conditions de formation
Cependant, la plupart des situations sont passagères et ne mettent pas en péril la formation, même si un quart de celles et ceux concerné‑e‑s indique que ces difficultés ont eu un impact important sur leur parcours.
L’étude montre aussi que les offres d’aide et d’accompagnement psychologique restent peu connues ou peu utilisées. C’est là un levier d’action clair pour les écoles et les entreprises formatrices: rendre ces dispositifs plus visibles, plus accessibles, et surtout déstigmatiser leur usage.
Avec ses 44 675 réponses, cette enquête offre un éclairage solide et représentatif.
Elle a été réalisée en collaboration avec le Secrétariat d’État à la formation (SEFRI), Promotion Santé Suisse et plusieurs fondations. Les réponses couvrent les trois régions linguistiques du pays. Pour l’UPCF, le message de cette enquête est porteur. “La formation duale ne prépare pas seulement à un métier.Elle aide aussi les jeunes à se construire, à trouver leurs repères et à prendre confiance en eux”, souligne Daniel Bürdel, directeur adjoint.
Dans ce contexte, marqué par une prise de conscience accrue de l’importance du bien-être en formation, qu’une nouvelle revendication a émergé. En juin 2025, une lettre ouverte a été adressée au Conseil fédéral pour réclamer huit semaines de vacances annuelles pour les apprenti-e-s, au lieu des cinq actuellement prévues. Cette initiative est portée par l’Union syndicale suisse (USS) .
Des préoccupations dans les milieux économiques
Mais cette proposition ne fait pas l’unanimité. Du côté des employeurs-euses et des milieux économiques, dont fait partie l’Union Patronale du Canton de Fribourg (UPCF), plusieurs voix s’élèvent pour alerter sur les conséquences potentielles d’un tel allongement des vacances. Si la santé psychique des apprenti-e-s est reconnue comme un enjeu central, la question se pose de savoir comment y répondre sans déséquilibrer un système qui repose sur la formation en entreprise, en école professionnelle et les attentes économiques.
En effet, cette mesure risquerait de diminuer encore le temps que passent les apprentis à l’entreprise formatrice et de détériorer le rapport coût/bénéfice de la formation pour les entreprises. « Accorder des semaines de vacances supplémentaires pourrait décourager les entreprises formatrices d’offrir des places d’apprentissage, appauvrissant les options de formation et mettant en péril le système de formation dual », explique le directeur adjoint de l’UPCF.
Il y a alors d’autres voix qui alertent sur le risque de déséquilibre entre formation en entreprise et enseignement scolaire. Le directeur du Service de la formation professionnelle de Genève a par exemple averti que tout allongement des vacances pourrait entraver la préparation aux examens, déjà dense et exigeante.
À ces considérations pédagogiques s’ajoutent des préoccupations d’ordre budgétaire. Dans un contexte économique incertain, le Grand Conseil genevois a qualifié l’hypothèse d’extension des vacances de « non réaliste », pointant les coûts supplémentaires qui en découleraient.
Enfin, du côté du PLR, on plaide pour davantage de flexibilité et de marge de manœuvre laissée aux employeurs-euses, afin de pouvoir aménager librement leur offre de formation – salaires, congés, avantages – en fonction de leurs possibilités, afin de proposer des places attractives sans contrainte uniforme. « La diversité des modèles est aussi une richesse du système dual », rappelle Daniel Bürdel.



